![]()
καθαροὶ : nominatif pluriel de καθαρός, ά, όν « pur, sans tache, sans souillure, propre ».
![]() Quelques termes en français sont issus de cette racine : catharsis (et l’adjectif correspondant cathartique) et cathare.
Quelques termes en français sont issus de cette racine : catharsis (et l’adjectif correspondant cathartique) et cathare.
-
La catharsis est un terme employé en philosophie et en psychanalyse. Il existait déjà en grec ancien et signifie « purification ». Selon Aristote (philosophe du IVème siècle av JC) il s’agit de l’effet produit sur les spectateurs par les représentations dramatiques, un effet de « purgation des passions. » En psychanalyse, on parle de catharsis pour désigner « la réaction de libération d’affects longtemps refoulés dans le subconscient et responsables d’un trouble psychique ». Il s’agit par exemple de réveiller par hypnose les souvenirs enfouis à l’origine du trouble pour créer une décharge émotionnelle à valeur libératrice.
- Le mot cathare (nom ou adjectif) fait référence à une secte manichéenne du Moyen-Âge (XIème au XIIIème siècle) répandue surtout dans la région d’Albi et préconisant une absolue pureté des mœurs. Les adeptes s’appelaient « les parfaits. »
ἡμέρης : génitif singulier de ἡ ἡμέρα « le jour, la durée d’un jour ».
En grec ancien le mot se rencontre combiné à de nombreuses prépositions pour exprimer des compléments de temps. Dès l’antiquité les adjectifs composés de ἐπί et de ἡμέρα, ἐφήμερος « qui ne dure qu’un jour » et ἐφημερίς, ίδος « de chaque jour » -plus rare et plus tardif, 1er siècle ap JC- existent.
![]() Le français utilise deux termes directement issus du grec ancien, éphémère et éphéméride.
Le français utilise deux termes directement issus du grec ancien, éphémère et éphéméride.
Éphémère est le plus souvent un adjectif mais peut aussi être un nom qui désigne un insecte dont la larve aquatique vit plus d’un an et l’adulte un seul jour.

Un éphéméride, après avoir désigné un ouvrage indiquant des données astronomiques, est dans le langage courant un calendrier dont on détache chaque jour une feuille.
![]() En grec moderne, le mot « journal » se traduit par εφημερίδα et si le journal est un quotidien par ημερήσια εφημερίδα.
En grec moderne, le mot « journal » se traduit par εφημερίδα et si le journal est un quotidien par ημερήσια εφημερίδα.
βύβλινα : accusatif pluriel neutre de βύβλινος, η, ον « fait avec des fibres ou des lamelles de papyrus ». L’adjectif est construit sur la racine de ὁ βύβλος «papyrus, tout objet fait en papyrus ». Les feuilles servant de tablettes pour écrire étant réalisées dans cette matière, le mot a désigné ensuite « le livre ». On trouve en grec ancien quatre formes équivalentes du mot : βύβλος, βίβλος, βύβλιον, βίβλιον.
L’origine de cette racine est le nom de la ville de Byblos en Phénicie (l’actuel Liban) qui exportait en grande quantité le papyrus.
La Bible désigne donc « le Livre » pour les Chrétiens. 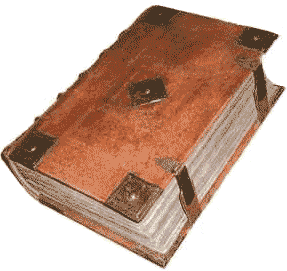
![]() Sur cette racine existent de nombreux mots en français : bibliothèque, bibliographie, bibliophile… et depuis 1930 bibliobus construit à partir de « biblio(thèque) » et « (auto)bus »…
Sur cette racine existent de nombreux mots en français : bibliothèque, bibliographie, bibliophile… et depuis 1930 bibliobus construit à partir de « biblio(thèque) » et « (auto)bus »…
μυρίας : accusatif pluriel féminin de μυρίοι, αι, α « très nombreux, innombrables, dix mille », parfois employé collectivement au singulier « infini ». Le mot ἡ μυριάς, άδος désigne le nombre de 10.000, ![]() une myriade.
une myriade.
Le français comme le grec ancien utilise cette racine pour indiquer un nombre précis, un myriamètre fait effectivement dix mille mètres, ou l’idée d’un nombre très grand comme pour myriapode « mille-pattes » (qui aurait même dix mille pattes) de μυρια + ὁ πούς, ποδός « le pied ».
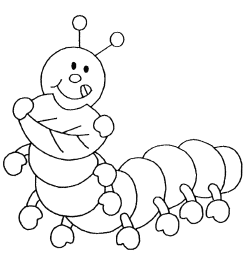
οἶνος : nominatif singulier masculin de ὁ οἶνος, ου « le vin ». Parmi les nombreux composés formés sur cette racine en grec ancien on trouve au IIème siècle ap JC le verbe οἰνολογεῖν « parler de vin », formé de οἰνο- et de λόγος .![]() C’est de ce verbe que sont tirés les mots œnologie (dès 1636) et œnologue (en 1801). Le XXème siècle créera encore oenolisme « alcoolisme par abus de vin » ou oenothèque « cave à vin, lieu où l’on déguste divers crus ».
C’est de ce verbe que sont tirés les mots œnologie (dès 1636) et œnologue (en 1801). Le XXème siècle créera encore oenolisme « alcoolisme par abus de vin » ou oenothèque « cave à vin, lieu où l’on déguste divers crus ».
ἰχθύων : génitif pluriel masculin de ὁ ἰχθύς, -ύος « le poisson ». En grec ancien on trouve, au IIème siècle ap JC, l’adjectif composé ἰχθυοφάγος « qui se nourrit de poisson » formé de ἰχθυο- et de φαγεῖν « manger ». Hérodote dans le livre III de son Histoire baptise ainsi un peuple habitant près du golfe Arabique : les Ichtyophages, « ceux qui vivent de poisson ».
![]() Ichtyophage existe encore en français. Sur cette racine ce sont les termes ichtyologie « partie de la zoologie qui traite des poissons », ichtyologiste « spécialiste d'ichtyologie » qui sont les plus connus mais tout un vocabulaire scientifique et paléontologique apparaît au XIXème siècle : ichtyoïde « qui ressemble à un poisson », ichtyornis « oiseau fossile du crétacé », ichtyosaure « grand reptile fossile ressemblant un requin », icthyose « maladie de la peau caractérisée par la sécheresse des téguments rugueux et couverts de grosses écailles »...
Ichtyophage existe encore en français. Sur cette racine ce sont les termes ichtyologie « partie de la zoologie qui traite des poissons », ichtyologiste « spécialiste d'ichtyologie » qui sont les plus connus mais tout un vocabulaire scientifique et paléontologique apparaît au XIXème siècle : ichtyoïde « qui ressemble à un poisson », ichtyornis « oiseau fossile du crétacé », ichtyosaure « grand reptile fossile ressemblant un requin », icthyose « maladie de la peau caractérisée par la sécheresse des téguments rugueux et couverts de grosses écailles »...
Le terme grec désignant le poisson a également un sens symbolique qui perdure depuis l’antiquité pour les Chrétiens : en grec, la langue des Évangiles, le mot poisson s'écrit « ichthus ». Chacune des cinq lettres grecques est le début d'un titre christologique que l'on traduit : Iésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. L'interdépendance entre l'idéogramme - ICHTHUS - et la représentation graphique du poisson s'est imposée rapidement chez les premiers Chrétiens.
