
Commentaire au fil du texte |

Cicéron est un homme politique romain, orateur et écrivain illustre dont une grande partie des oeuvres a été conservée. Sa correspondance, à l'origine destinée à un usage privé, permet de connaître l'homme derrière le personnage public des discours. Neuf cent trente et une lettres ont été conservées (dont 70 adressées à lui), écrites entre 68 et 43 av. J.C. : Ad Atticum, Ad familiares, Ad Quintum fratrem, Ad Brutum. Tiron, d'abord esclave de Cicéron puis affranchi, était son secrétaire particulier. C'est à lui qu'il revient d'avoir inventé un système de prise de notes rapide, ancêtre de notre sténographie. Sur ce sujet, lire la communication de Denis Muzerelle.
|
La lettre, comme aujourd'hui, comporte traditionnellement une formule de salutation et une formule d'adieu. |
Andricus (i, m.) et Acastus (i, m.) sont sans doute des esclaves. Ummius (ii, m.) doit être l'intendant puisque c'est à lui que revient de régler le médecin. |
Le calendrier |
L'expression de la date... Les Romains dataient à partir de trois jours repères : Calendae (arum, f. pl.), Nonae (arum, f. pl.), Idus (uum, f. : les Ides). Le compte se faisait à rebours à partir du jour repère suivant (le jour que l'on voulait dater) en le prenant en compte. Le numéral (ordinal) était à l'ablatif, puis, avec l'anticipation de ante (+ acc.), l'accusatif a été étendu partout : N.B. la veille d'un jour repère, les Romains emploient le terme pridie ; ex. le 31 décembre = pridie Kal. Ian. Consulter un calendrier. |
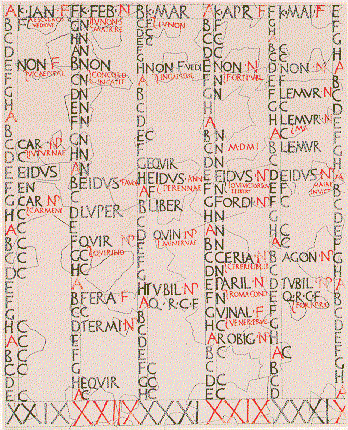 |
L'expression de l'heure La journée (dies, diei, m.) -comme la nuit- est divisée en 12 heures (hora, ae, f) entre le lever et le coucher du soleil óles heures sont donc plus ou moins longues selon la saison ; seule la 6e heure se terminait toujours à midi (meridies, iei, m). |