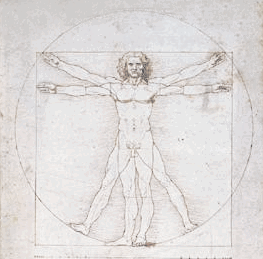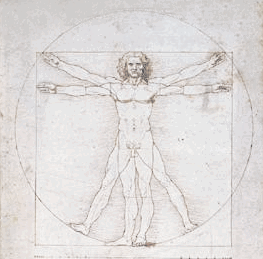|
[André BONNARD, Civilisation grecque.
T. I : De l'Iliade au Parthénon. Lausanne, La Guide du
livre, 1954, pp. 147-154]
Mais l'esclave n'est pas, dans la société athénienne,
le seul être humain à manquer à la démocratie.
A côté de lui, presque aussi méprisée que
lui, il y a la femme. La démocratie athénienne est une
société rigoureusement, farouchement masculine. Elle souffre,
à l'égard des femmes, comme à l'égard des
esclaves, d'une grave " discrimination" qui, pour n'être
pas raciale, n'en a pas moins les effets déformants d'un racisme.
Il n'en avait pas toujours été ainsi. Dans la société
grecque primitive, la femme était hautement vénérée.
Tandis que l'homme s'adonnait à la chasse, la femme non seulement
élevait les enfants, ces " petits " de l'homme si lents
à pousser, mais elle apprivoisait les animaux sauvages, recueillait
les herbes salubres, veillait sur les précieuses réserves
du ménage. En contact étroit avec la vie de la nature,
c'était elle qui détenait les premiers secrets qui lui
étaient arrachés, elle aussi qui fixait les tabous que
la tribu devait respecter pour vivre. Tout cela, antérieurement
même à l'installation du peuple grec dans le pays qui prit
son nom.
La femme, dans le couple, avait l'égalité et même
la primauté. Il ne faut d'ailleurs même pas parler de couple
: il n'y avait pas alors de mariage monogamique, mais des unions successives
et temporaires, dans lesquelles c'était la femme qui choisissait
celui qui lui donnerait un enfant.
Quand les Grecs envahirent, par vagues, le sud de la péninsule
des Balkans et la côte asiatique de l'Egée, ils trouvèrent
des populations qui vivaient, pour la plupart, sous le régime
du matriarcat. Le chef de famille, c'était la mère - la
" mater familias" - et la parenté se comptait selon
la ligne féminine. Les plus grandes divinités étaient
des divinités féminines, qui présidaient à
la fécondité. Les Grecs adoptèrent deux d'entre
elles au moins : la Grande Mère ou Cybèle, et Déméter,
dont le nom signifie Terre-Mère ou Mère du blé.
L'importance du culte de ces deux déesses, à l'époque
classique, rappelle la prééminence de la femme dans la
société grecque primitive.
Les peuples dits Egéens, les Pélasges, les Lydiens, bien
d'autres conservaient ou le régime matriarcal ou des usages matriarcaux.
Ces peuples étaient pacifiques : il n'y a pas de fortifications
au palais de Cnossos. Ils étaient agricoles. Ce sont les femmes
qui, inaugurant l'agriculture, ont amené l'humanité à
la vie sédentaire, étape essentielle de son évolution.
Les femmes jouissaient d'un grand prestige chez les peuples crétois
et dominaient encore la communauté.
La littérature grecque conserve en grand nombre des légendes
où la femme est peinte des plus belles couleurs. Surtout la littérature
la
plus ancienne. Andromaque et Hécube dans l'Iliade, Pénélope
dans l'Odyssée, sans oublier ni Nausicaa ni Arété,
reine des Phéaciens, soeur du roi son mari et souveraine maîtresse
de ses décisions, autant de femmes qui sont avec les hommes sur
pied de parfaite égalité et parfois mènent le jeu,
et qui apparaissent comme les inspiratrices, les régulatrices
de la vie des hommes. Dans certains pays grecs, comme l'Eolide de Sapho,
la femme longtemps garda ce rôle éminent dans la société.
Il en est tout autrement dans la démocratie athénienne
et, d'une façon générale, en pays ionien. Certes
la littérature garde l'image de belles figures féminines.
Mais les citoyens athéniens n'applaudissent Antigone et Iphigénie
qu'au théâtre. Un divorce profond s'est installé,
sur ce point, entre la littérature et les moeurs. Antigone est
désormais recluse dans le gynécée ou dans l'opisthodome
du Parthénon. Si elle est autorisée à en sortir,
ce n'est guère qu'à la fête des Panathénées,
où elle figure dans le cortège qui porte à la déesse
Athéna son nouveau voile, qu'elle a brodé, avec ses compagnes,
durant les longs mois de sa claustration.
Cependant, concurremment avec ces images de femmes idéales, la
littérature commence à présenter une image déformée
et qui paraît d'abord grimaçante de la femme. Toute une
veine de misogynie traverse la poésie grecque. Elle remonte haut,
à Hésiode à peu près contemporain du poète
de l'Odyssée. Hésiode, le vieux paysan ronchonneur, raconte
comment Zeus, pour punir les hommes d'avoir reçu de Prométhée
le feu qu'il lui avait volé, ordonne aux dieux et déesses
de se mettre à trois ou quatre pour fabriquer d'argile humide,
de douloureux désir, d'astuce et d'impudence ce beau monstre,
la femme - "piège-précipice aux parois abruptes et
sans issue ". C'est à la femme que l'homme doit tous les
malheurs de sa condition d'animal effaré. Hésiode est
intarissable sur le sujet de la ruse, de la coquetterie et de la sensualité
féminines.
Non moins que le poète Simonide d'Amorgos qui, dans un poème
tristement célèbre, injurie grossièrement les femmes,
qu'il classe pédantesquement en dix catégories, usant
de comparaisons animales
et autres. Il y a la femme qui vient de la truie : " Tout est désordre
dans sa maison, tout roule pêle-mêle dans le bourbier, elle-même
ne se lave point, elle porte des vêtements malpropres et, assise
sur son fumier, elle engraisse. " Il y a la femme-renarde, toute
en manigances, la femme bavarde et cancanière qui, fille de la
chienne, aboie sans arrêt et que son mari ne peut faire taire,
même en lui cassant les dents à coups de pierre. Il y a
la femme paresseuse, aussi lourde à remuer que la terre d'où
elle provient. Et la fille de l'eau, changeante et capricieuse, tantôt
furieuse et déchaînée, tantôt douce et riante
comme la mer un jour d'été. La femme-ânesse, têtue,
gloutonne et débauchée, la femme-belette, méchante
et voleuse. Il y a la femme-cavale : elle est trop fière pour
se plier à aucun travail, elle refuse de jeter les balayures
hors de la maison; vaine de sa beauté, elle se baigne deux et
trois fois par jour, s'inonde de parfums, pique des fleurs dans ses
cheveux, " admirable spectacle pour les autres hommes, fléau
pour son mari ". Il y a la femme-guenon, d'une laideur si repoussante
qu'il faut plaindre " le malheureux mari qui la serre dans ses
bras ". De tant de femmes détestables, la dernière,
qui est la femme-abeille, ne nous console pas.
Cette poésie, brutalement antiféminine, reflète
le renversement profond qui, des temps primitifs aux siècles
historiques, s'est accompli dans la condition de la femme.
En s'installant, le mariage monogamique n'a point favorisé la
femme. L'homme y est maintenant le maître. La femme jamais n'a
choisi et la plupart du temps n'a même pas vu son futur mari.
L'homme se marie pour la seule " procréation d'enfants légitimes
". Le mariage d'amour n'existe pas. L'homme a trente ans au moins,
la femme, qui en a quinze, consacre sa poupée à Artémis
la veille de ses noces. Le mariage est un contrat qui n'oblige guère
que l'une des deux parties. Le mari peut répudier sa femme et
garder les enfants, sans autre formalité qu'une déclaration
devant témoins, à condition de rendre la dot ou d'en payer
les intérêts. Le divorce demandé par la femme, en
revanche, aboutit très rarement et seulement en vertu d'une décision
judiciaire motivée par des sévices graves ou une infidélité
notoire. Mais cette infidélité est dans les moeurs : elle
a bonne conscience.
Le mari ne se prive ni de concubines, ni de courtisanes. Un discours
attribué à Démosthène déclare : "
Nous avons des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour être
bien soignés et des épouses pour nous donner des enfants
légitimes. "
La femme légitime devait être fille de citoyen. Elle avait
été élevée, en petite oie blanche, dans
ce gynécée qui est son domaine, et presque sa prison.
Mineure de la naissance à la mort, elle ne fait que changer de
tuteur en se mariant. Si elle devient veuve, elle passe sous l'autorité
de son fils aîné. Elle ne quitte guère le gynécée
où elle surveille le travail des esclaves, auquel elle participe.
A peine sort-elle pour une visite à ses parents, ou pour aller
au bain, et toujours sous l'étroite surveillance d'une esclave.
Parfois en compagnie de son seigneur et maître. Elle ne va même
pas au marché. Elle ne connaît pas les amis de son mari,
ne l'accompagne pas à ces banquets où il les retrouve
et auxquels il lui arrive d'emmener ses concubines. Sa seule occupation
est de donner à son mari les enfants qu'il désire, d'élever
ses fils jusqu'à sept ans, âge auquel ils lui échappent.
Elle garde ses filles et les forme, dans le gynécée, à
la vie qu'elle a menée elle-même, à la triste condition
de ménagère reproductrice. La femme d'un citoyen athénien
n'est qu'un " oïkouréma ", un " objet (le
mot est neutre) fait pour les soins du ménage ". Ce n'est
pour l'Athénien que la première de ses servantes.
Le concubinat se développa beaucoup dans les siècles classiques
d'Athènes. C'est une sorte de mi-mariage et de mi-prostitution.
Sur ce terrain non pas reconnu mais toléré et favorisé
par 1'Etat, grandirent les seules personnalités féminines
athéniennes dont le souvenir soit venu jusqu'à nous. La
belle et brillante Aspasie, brillante de toutes les séductions
de l'esprit et du savoir, experte, dit-on, dans l'art nouveau de la
sophistique, était la fille d'un Milésien. Périclès
l'installa dans sa propre maison, après avoir répudié
sa noble femme légitime. Elle y tint salon et son pseudo-mari
sut, malgré une campagne d'injures, l'imposer à la société
athénienne. Lui qui, dans un discours officiel, déclarait,
selon Thucydide, que le mieux que puissent faire les femmes " était
de faire parler d'elles le moins possible par les hommes, soit en bien
soit
en mal ", il affichait son commerce avec cette " hétaïre
" (le mot signifie simplement " amie ") de haut vol.
Ainsi le cas d'Aspasie et d'autres montre qu'une femme devait commencer
par se faire à demi courtisane pour acquérir une personnalité.
Ce fait est la con-damnation la plus sévère qui soit de
la famille athénienne.
Le concubinat est toléré par Platon dans son Etat idéal,
à condition que les hommes cachent leurs " amies "
et qu'elles ne causent pas de scandale.
Et ne parlons pas des prostituées dites de bas étage -
des esclaves en grande partie, mais non pas toutes - qui emplissaient
les bordels d'Athènes et du Pirée et que les jeunes gens
pouvaient s'offrir pour une obole. Prostitution officielle dans ces
maisons dont Solon avait été le fondateur, pour assurer
le bon ordre et la moralité publique.
Mais comment donc et à quel moment s'était opérée
une révolution si complète dans la condition de la femme
? Comment les Andromaque, les Alceste de la légende devinrent-elles
les Aspasie de la réalité ou les épouses et concubines
aux noms inconnus, simples esclaves du plaisir de l'homme ou instruments
de reproduction ? Un fait est certain : il y eut un moment où
le sexe féminin subit sa plus grave défaite. Maîtresse
de la communauté familiale dans les temps matriarcaux, la femme
aux siècles de la Grèce classique est tombée dans
la condition la plus humiliée. Quand s'est produite cette "grande
défaite historique de la femme" ? On en est réduit
ici à des suppositions. La plus vraisemblable est qu'elle est
liée à la découverte des métaux et au développement
de la guerre en industrie de grand rapport.
Les hommes découvrent le cuivre et, l'alliant à l'étain,
ils se fabriquent les premières armes de bronze. Puis ils découvrent
le fer dont ils font des armes nouvelles, pour le temps fort redoutables.
En possession de ces armes, ils font de la guerre une affaire qui devient
d'un immense profit. Les pillards achéens emplissaient d'or les
tombes des rois de Mycènes. Les Doriens détruisent les
restes de la pacifique civilisation des Egéens. Ceci se passe
tout au début des temps historiques.
Avec la civilisation égéenne s'écroule du même
coup la primauté de la femme et s'installe le prétendu
mariage monogamique. C'est que l'homme, seigneur de la guerre, veut
pouvoir transmettre les richesses qu'elle lui procure à des enfants
dont il soit sûr d'être le père. De là le
mariage monogamique qui fait de la femme légitime un instrument
de procréation, des autres un objet d'agrément ou de plaisir.
Les restes du matriarcat furent d'ailleurs lents à disparaître.
Sans parler des légendes qui les véhiculent, par la poésie
tragique, jusqu'au coeur de l'époque classique, la femme garda
longtemps des droits qu'elle a perdus depuis et n'a pas encore recouvrés
partout. Ainsi le droit de vote que les Athéniennes possédaient
encore, selon un savant helléniste anglais, à l'époque
de Cécrops (qu'il faut situer au xe siècle environ).
Le comble, c'est que le poète tragique Euripide, quand il se
mit à traiter la tragédie en réalisme, à
peindre les femmes ou bien avec les défauts très réels
que les pressions sociales qu'elles subissaient leur avaient inculqués,
ou bien, dans la manière noble mais vraie, telles que la légende
les présentait, mais, si proches, si familières qu'elles
devenaient réellement les épouses, les soeurs et les filles
des spectateurs - Euripide fit jeter les hauts cris à tout Athènes,
il se fit traiter lui-même de misogyne. Qu'il ait dit des femmes
ou trop de bien ou trop de mal, c'était la même chose,
toujours misogynie. Euripide paya fort cher, auprès de ses contemporains,
de n'avoir pas respecté l'impérieuse consigne de Périclès
: " Silence sur les femmes, silence sur leurs vertus, silence sur
leur malheur." Il les aimait trop pour se taire...
Mais la dénaturation de la femme eut une conséquence sociale
bien plus grave. On sait, en effet, quelle perversion s'introduisit
dans le sentiment de l'amour qui, incapable chez l'homme de prendre
pour objet un être aussi dégradé socialement que
la femme, devint ce qu'on appelle l'amour grec - cette pédérastie
dont la littérature antique est remplie. La littérature,
la mythologie - et la vie.
La condition de la femme est donc, dans la société antique,
une plaie aussi grave que l'esclavage. La femme exclue de la vie civique
appelle autant que l'esclave une société, une civilisation
qui lui rendront l'égalité des droits avec l'autre sexe,
qui lui rendront sa dignité et son humanité.
Et c'est aussi pourquoi ce fut parmi les femmes - je l'ai dit - autant
que parmi les esclaves que le christianisme se répandit. Mais
les promesses du christianisme primitif - promesses de libération
de la femme et de l'esclave - ne furent qu'imparfaitement tenues. Du
moins en ce monde terrestre où nous vivons.
Combien de révolutions ne fallut-il pas, ne faudra-t-il pas,
après la révolution chrétienne, pour retirer la
femme de l'abîme où l'a plongée sa " grande
défaite historique" ?
|